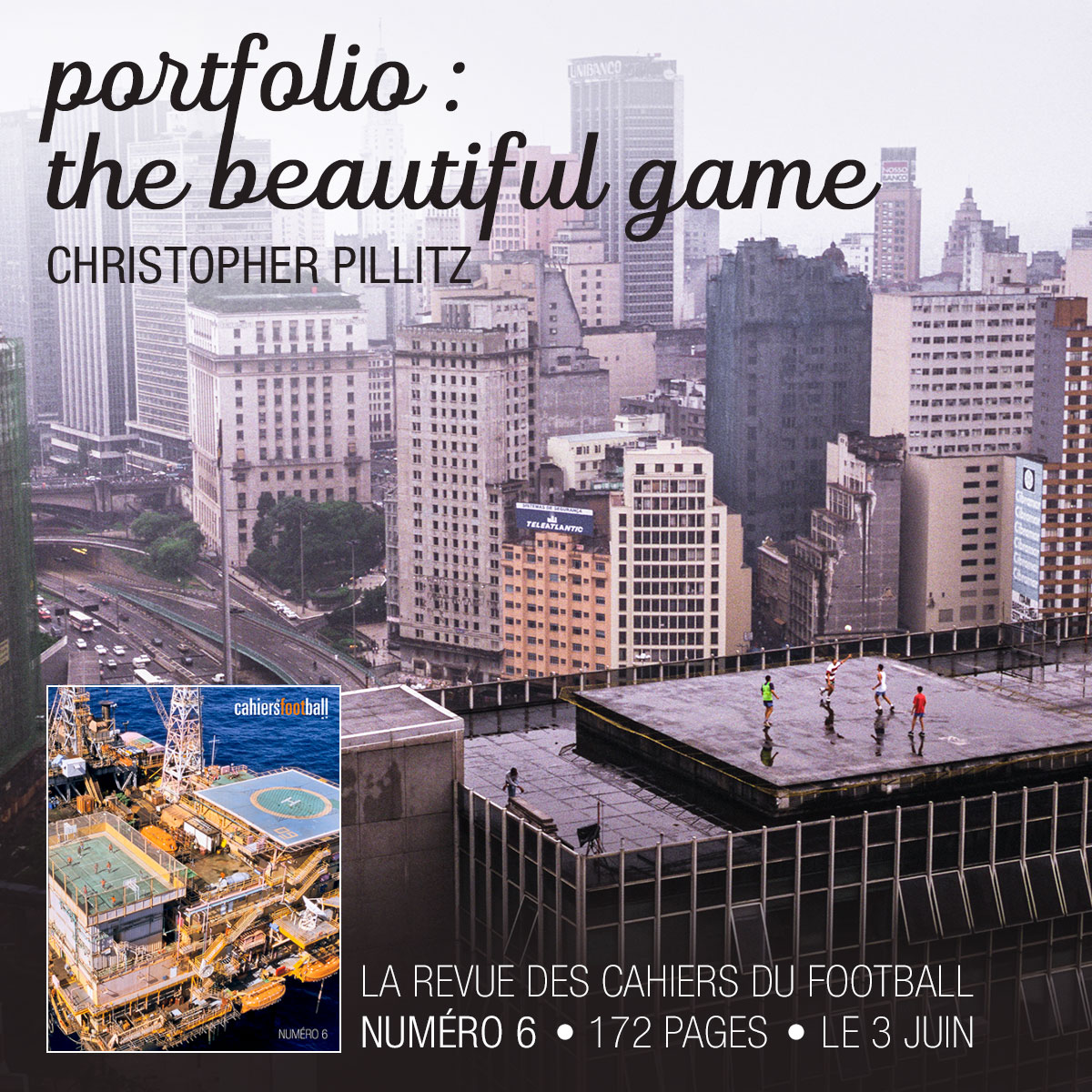Nanard Land
De 1986 à 1994, Bernard Tapie a marqué de son passage l’OM et le football français, pour le meilleur et pour le pire – les deux étant souvent liés.
Bernard Tapie a déboulé dans le foot au cœur des années 1980 avec sa grande gueule, ses mauvaises manières et ses certitudes. Lorsqu’il prend la tête de l’Olympique de Marseille en 1986, les instances se félicitent d’accueillir le charismatique homme d'affaires, véritable figure médiatique de la réussite entrepreneuriale des années Mitterrand.
Huit ans plus tard, aucun détracteur ne peut nier la réussite de l’opération: le patron de Wonder et de La Vie Claire a permis à un club français de décrocher la Coupe d’Europe des clubs champions. Un fait unique dans l’histoire. Aucun supporter ne peut par contre nier que le règne du boss s’est déroulé dans une ambiance sulfureuse, teintée de suspicions… et bientôt de condamnations.

La possibilité de la victoire
Avant même le grand soir du 26 mai 1993, Bernard Tapie avait rendu possible, dans l’esprit des amateurs de foot, l’idée qu’un club français puisse remporter une Coupe d’Europe. Même Claude Bez et ses Girondins de Bordeaux n’avaient pas rendu à ce point les choses imaginables en dépit de parcours européens intéressants mais inachevés.
"Je veux gagner la Coupe d’Europe, lança Tapie un jour à Télé-Foot. J’ai pas dit 'J’voudrais bien', j’ai dit 'Je veux'!" La déclaration aura pour écho son "Maintenant, je sais comment on gagne une Coupe d'Europe!", prononcé après la fameuse main de Vata, en avril 1990.
Cet esprit de gagne à tout prix, quasiment inédit en France, Bernard Tapie a su le transmettre à ses joueurs. Tout ne s’est pas fait en un jour, il a fallu avaler quelques désillusions, mais ils ont su surmonter le complexe du petit Français, en faisant notamment trébucher, en deux mémorables occasions, le plus grand club de l’époque, l’invincible AC Milan.
On peut penser aujourd’hui que l’exploit de Munich a conditionné des joueurs comme Didier Deschamps, Marcel Desailly et Fabien Barthez, et que ceux-ci ont acquis un mental suffisant pour envisager très sérieusement de remporter la Coupe du monde en 1998.
Bernard Tapie a aussi rendu possible l’idée que le championnat de France pouvait être aussi sexy que celui d’Italie ou d’Espagne. Tout simplement en rendant envisageable l’arrivée du meilleur footballeur du monde dans notre championnat.
Il s’en est fallu de peu que Diego Maradona, alors dieu vivant du football mondial, joue régulièrement contre Nantes, Sochaux ou Lens, et se traîne dans la boue des premiers tours de la Coupe de France contre Schiltigheim ou Bourg-Péronnas.
Le roi Diego n’a jamais vu la Bonne Mère, mais l’OM a quand même su attirer des noms qui paraissaient inaccessibles au championnat de France, comme Karl-Heinz Forster ou Rudi Völler, et ce au cœur de leur brillante carrière.
Super président
Bernard Tapie s’était inscrit dans une culture bien française des super-présidents de club qui attirent toute la lumière à coup de déclarations tapageuses. À l'instar de Roger Rocher, Marcel Leclerc, Claude Bez et plus tard Jean-Michel Aulas, Tapie était devenu la figure centrale de son club. Une tradition amplifiée par le fait que le foot n’était pas son seul motif d’existence.
À l’OM, Bernard Tapie faisait tout. Il présidait, recrutait, composait l’équipe et assurait lui-même le speech d’avant-match. Il aimait pourtant s’entourer de grandes figures, tels Michel Hidalgo ou Franz Beckenbauer, mais il les réduisait rapidement, sans doute à son corps défendant, au rang d’apparat décoratif. À l’OM, il y avait le boss et ses joueurs.
C’est Tapie lui-même qui a recadré Éric Cantona après que celui-ci eut jeté son maillot sur la pelouse. C’est Tapie aussi que Didier Deschamps a dû convaincre de ses qualités alors que le boss ne comptait en faire qu’une monnaie d’échange.
Les entraîneurs qui se sont succédé sur le banc se sont retrouvés relégués au rang d’adjoints de luxe, ce que très peu ont supporté à l’exception notable du rusé Raymond Goethals, seul personnage de l’épopée capable de conquérir la confiance du boss et des joueurs.
Quelle était la part de Tapie dans la composition des équipes de l’OM? Avait-il un réel sens tactique comme il aimait le prétendre face aux caméras? Les joueurs qui évoquent cette époque aiment bien sûr entretenir la légende, mais d’autres insistent sur le rôle déterminant de Goethals.
Lorsque le boss en avait fini avec son speech, l’entraîneur lui succédait, demandait aux joueurs de tout oublier et de se concentrer sur ses consignes à lui. Le retour calamiteux de Tapie en 2001, en tant que directeur sportif, ne plaide pas vraiment en faveur de son génie du jeu.
Un empire olympien
En dehors du club, Tapie suscitait également autant d’admiration que d’animosité. Notamment de la part de Claude Bez, le président des Girondins de Bordeaux qui a rapidement senti diminuer l'emprise qu’il exerçait sur le foot français. Les prises de bec entre les deux présidents sont restées dans les mémoires, plus souvent que les oppositions entre leurs équipes respectives.
Les deux hommes étaient aux antipodes – la figure médiatique face au notable de province, le costard décontracté face au pardessus gris, le sourire carnassier face à l’épaisse moustache. Rarement affrontements entre chefs de clubs n’avaient été si savoureux.
Parmi les griefs que le foot français portaient contre Tapie était celui d’appauvrir les autres clubs du championnat. Bénéficiant de moyens largement supérieurs, Tapie recrutait chez ses concurrents directs, bâtissait chaque intersaison une sorte d’équipe-type du précédent championnat.
Pourtant, même s’il disposait de la meilleure équipe possible sur le papier, l’OM trouvait sur sa route un Bordeaux, un Monaco ou un PSG qui se posait en sérieux rival jusqu’au bout de la saison. Le club marseillais qui additionne les titres de champions de France a rarement bouclé une saison en roue libre, à la manière d’un PSG des années 2010.
Le boss de l’OM déclarait non sans cynisme qu’il enrichissait les autres clubs en leur achetant des joueurs. Mais il avait aussi tendance à en contacter avant les matches importants, son plus gros coup restant probablement le recrutement de Didier Deschamps quelques jours avant un Nantes-OM en championnat. Un transfert qui a repoussé un peu plus loin les usages alors en vigueur.
La combine à Nanard
L’OM achetait beaucoup de joueurs, il en prêtait aussi beaucoup. On se souvient de l’Argentin Leo Rodriguez à Toulon, ou du Croate Alen Boksic à Cannes... entraînant un climat assez malsain, surtout à la lumière de l’affaire qui allait le faire chuter en 1993. Des joueurs de classe mondiale généreusement prêtés à des clubs du ventre mou, oui, mais contre quelle contrepartie ?
Lorsque Canal+ a repris le Paris Saint Germain en 1991, Tapie s’est ostensiblement montré favorable au projet, livrant même d’entrée trois de ses joueurs en échange d’un Parisien qu’il convoitait depuis longtemps. Selon ses dires, le championnat de France méritait un clasico, et l’OM avait besoin d’un rival à sa taille.
Oubliant combien Bordeaux ou Monaco lui avaient donné du fil à retordre, il accorda au club parisien un statut abusif de rival historique. S’il a créé de toutes pièces l’hystérie qui entoure depuis les rencontres PSG-OM, Tapie donna surtout l’image d’un homme avide de contrôler les adversaires de son équipe.
Peut-être les matches arrangés ont-ils existé avant l’arrivée de Bernard Tapie, sans doute de manière artisanale. Lorsque l’on a découvert que les dirigeants de l’OM avaient corrompu des joueurs de l’US Valenciennes, une équipe a priori peu dangereuse, on imagina rapidement qu’ils avaient érigé la pratique en système.
Les doutes pèsent aujourd’hui sur de nombreux matches, au point que l’on se demande s’il y a un seul titre conquis durant cette période qui n'ait pas été entaché d’un arrangement ou deux. VA-OM, probable partie émergée d'un iceberg…
Le glorieux soir de Munich et la rencontre contre Valenciennes n’ont que cinq jours d’intervalle. Elles représentent aujourd’hui le sommet du club phocéen et sa descente aux enfers. Deux événements tellement liés que l’un semble être le prix à payer pour obtenir l’autre. Deux faces d’une même pièce, l’une sombre et l’autre lumineuse. Docteur Tapie et Mister Bernard.